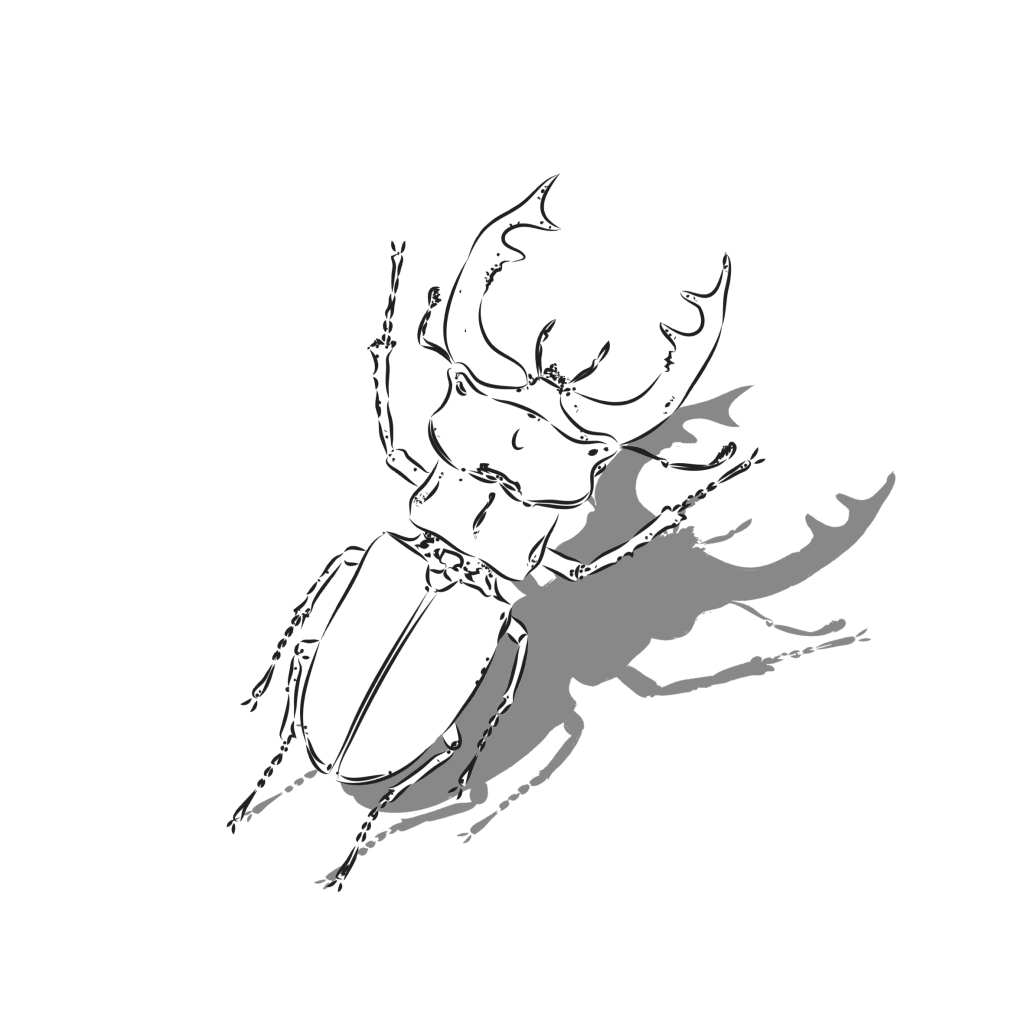Le verbe enfricher se conjugue avec des verbes à l’infinitif. Une manière d’éviter le piège de la définition. Car, par définition, on ne comprend pas un processus en le définissant. Pour comprendre un processus, le prendre avec soi, on tente d’en saisir le mouvement, les courbes, les reliefs les spécificités. Si l’on peut, on y pénètre on va « dans », « entre », « en ». On cherche comment on y prend part, à comprendre comment il nous traverse. On le subit, il nous agit. Définir un processus, c’est en fait définir une séquence dans le processus, d’opérer une coupe, d’isoler le processus avec le risque de le tuer ou que le processus, ce qu’il produit, ce qu’il crée nous échappe.
J’ai d’abord envisagé la formule en friche dans une forme nominale, non-verbale ou encore métaphorique. J’évoquais alors une recherche en friche ou un « doctorat en friche » qui se déclinerait sous d’autres formules une université, une pédagogie, une sociologie, une écriture en friche. Puis j’ai découvert la forme verbale « enfricher » au sein de la friche artistique Lamartine, chez les ami·es qui écrivent leurs friches pas uniquement depuis une pratique artistique mais aussi depuis une pratique du lieu. Des pratiques et des recherches qui se parlent se vivent aussi en mots, en expressions, en langues, en assemblages. Enfriche se localise nécessairement quelque part dans l’entremêlement-en-train-de-se-faire entre des pratiques, des mots, des espaces, des usages, des objets…
En friche me renvoie à un dedans, mais qui, réciproquement, en produit les effets au-dehors. En-friche enfriche, en friche met en friche, protubère et prolifère la friche.
« En » : il n’y a pas un début qui amène à une fin mais un milieu qui produit du milieu.
Enfricher, dans sa forme verbale, signifie que quelque chose de la friche a été plus fort que l’intention de départ. Le lieu happe, il déborde. Par poétique, un renversement peut opérer. Ce que l’on subit, le non-intentionnel, peut se mettre à agir quelque chose. La friche astreint à rester pour une soirée alors qu’on ne passait qu’une ou deux heures pour travailler. On est accueilli·es en résidence pour une semaine, mais on y reste plusieurs années, sans être vraiment sûr du pourquoi ou du comment. On réalise un mémoire étudiant sur la friche, et on y développe finalement l’idée d’une recherche en friche, au milieu d’autres recherches en friche et avec les moyens du bord.
S’enfricher, c’est sentir au travers de nos mots, nos gestes, nos humeurs ou nos pratiques que la friche a un effet observable, identifiable mais imprévisible sur ce qui était planifié.
Enfricher tisse des liens et des lieux précaires avec l’imprévu — pour reprendre les mots et les imaginaires que travaillent Pierre Johan Lafitte [P-J, Lafitte, Tisser des lieux, habiter les liens précaires qui maillent l’humain, Agencements n°13, p.84]. C’est un processus contre nos propres planifications, contre nos projections trop bien ficelées, contre l’établissement — on se positionne pour se déplacer et vice-versa. C’est un processus précaire. Parce que ce terme renvoie aujourd’hui d’abord à des situations difficiles, de grandes difficultés, parce qu’un néolibéralisme féroce, qui précarise chaque parcelle d’existence, nous prive de ce terme, en-friche devient le moyen de venir dire ce « sens du précaire » cher à la psychothérapie institutionnelle et à nos pratiques.
« Bien sûr, -les mots « précaire » et « précarité » résonnent aujourd’hui étrangement à nos oreilles. Dommage collatéral du néolibéralisme, la précarité est une des variables d’ajustement que les entreprises donnent en gage aux marchés financiers ; armée de réserve du capitalisme, les précaires sont à côté des chômeurs, les nouvelles figures du capital humain flexible de notre temps. Mais, loin de cette précarité imposée par le système économique et subie à leur corps défendant par la plupart des citoyens, à l’opposé de cette conception d’une précarité devenue synonyme de consommable et jetable, c’est évidemment d’un tout autre « sens du précaire » qu’il s’agit ici : un sens du précaire respectueux de « l’humanité en l’homme », et qui déjoue toute forme d’aliénation. » [Olivier Apprill, Une avant-garde psychiatrique. Le moment GTPSI (1960-1966), p. 94]
Enfricher travaille ce « sens du précaire » qui donne « la part belle au non-intentionnel, au non-directif, au non-programmatique[…] ». [Olivier Apprill, p. 95] . Un sens du précaire qui ne serait se résumer à une esthétique dans le cadre d’un texte, d’une langue qui s’enfricherait, d’un lieu, une esthétique dans laquelle se logeraient des pratiques confortablement installées, pas si précaires. Ce sens du précaire, de l’enfriche sillonne les processus dans lesquels nous sommes engagé·es, des processus chancelants, autonomes qui ne se font pas tout seul pour autant.