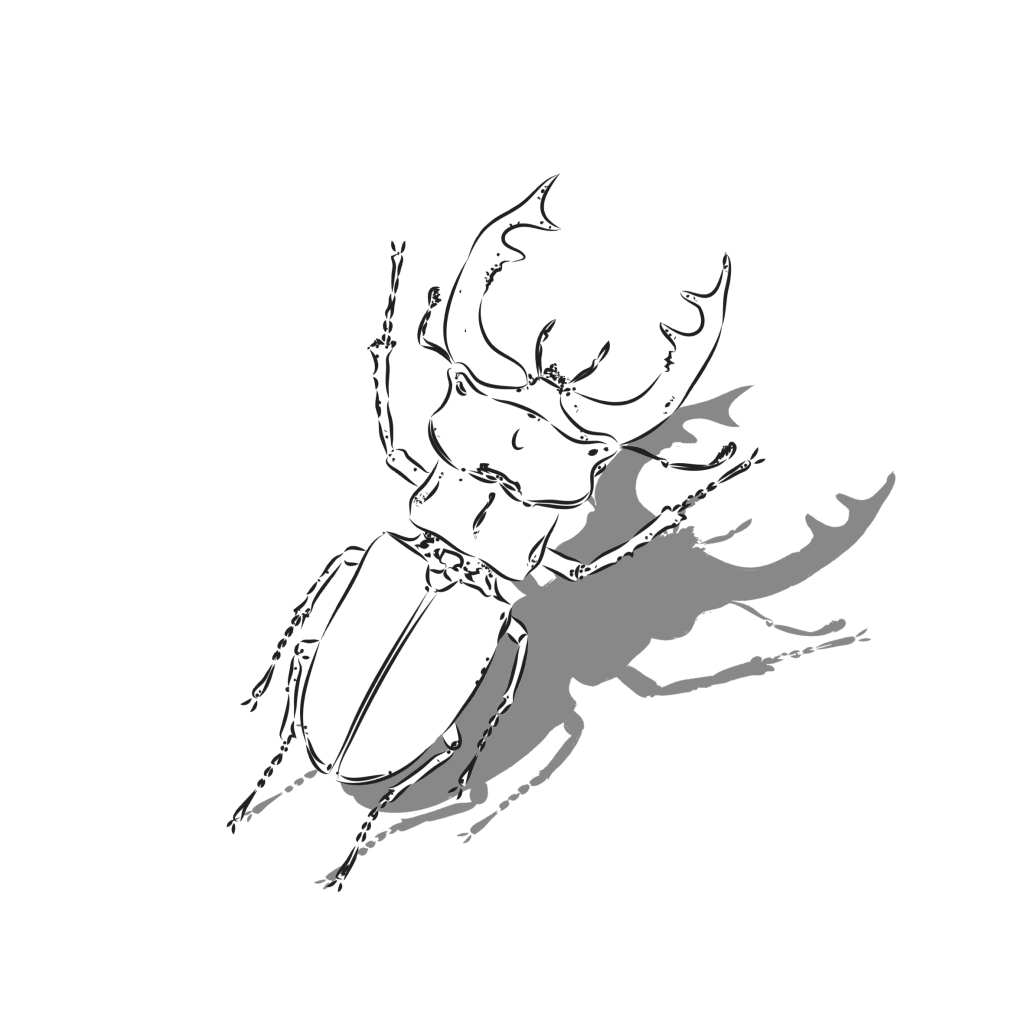NOUER ( je, nous, noeuds)
Avec cette lecture et cette invitation, j’ai trouvé une occasion pour ouvrir le chantier d’un texte que j’écris timidement, çà et là. Un texte que je peine à écrire, tant l’idée de tomber dans le registre du chercheur qui écrit « sur », et qui trahirait les siens, m’effraie. C’est une autre invitation, qui m’a motivé à me défaire, non pas de cette attention, car elle est nécessaire, mais plutôt à me défaire de la façon dont la crainte de mal faire nous immobilise et nous conduit à ne rien faire. Cette invitation est faite par Marielle Macé à travers son livre Nos cabanes. Une invitation à partager nos cabanes comme elle nous partage la sienne. Lorsque j’ai lu son livre, j’ai compris que ma cabane était une friche et que quelque chose de ma friche était aussi un peu dans cette cabane en forme de livre jaune.
Le présent texte conjugue momentanément ces deux invitations, qui sont aussi deux lectures, et qui se sont croisées dans le temps et l’espace de ma recherche. C’est une tentative, par l’écriture, de nouer ma friche avec d’autres friches, quelle qu’en soit leurs formes, une tentative de mettre en partage des je, des nous et des nœuds.
« Nous » ne signifie pas : les miens, tous ceux qui sont pareils que moi; mais : tous ceux qui pourront être le « je » de ce « nous », l’endosser, le reprendre à leur compte, en éprouver la force. Il ne s’agit pas avec « nous » de dire qui je suis, de me déclarer ; il ne s’agit pas même de dire comme qui je suis; mais ce que nous pourrons faire si nous nous nouons. « Nous » ne saurait ouvrir à la question de l’identité (en es-tu?), mais à la tâche qui consiste à faire et défaire des collectifs (oui, aussi défaire), des pluriels suffisamment soudés pour qu’ils puissent s’énoncer.
(Peut-être « nous » est-il alors quelque chose comme le pluriel de « seul » : il ne se fait pas à partir de nos « je », affirmés ou vacillants, mais à partir de nos solitudes ; il les met en commun, c’est-à-dire qu’il les rassemble, les surmonte en les rassemblant, et à certains égards les maintient. Nous faisons et défaisons des collectifs avec ces solitudes et non pas malgré elles. Nous ne nouons rien d’autre, et c’est déjà tellement, que notre égal tremblement, nos égales potentialités.)
Nouons-nous donc, en sachant ce que l’on dit quand on dit « nous », ou ce qu’on ne voudrait pas dire. Car on pressent aussi, dans cette formule, que quelque chose peut très vite se mettre à bégayer, à s’enrayer dans la profération du « nous », une hâte de s’y réchauffer, à s’y trouver à son aise, à s’y dénombrer et à compter ses rangs, un « nous » très noué qui se referme alors sur un nous comme un enclos, et que l’on connaît très bien aujourd’hui ». [Marielle Macé, Nos Cabanes, p. 21]
Si les deux invitations se conjuguent, elles conjuguent aussi deux approches qui, d’une certaine façon, peuvent sembler contradictoires. (Rien n’indique que ce qui est contradictoire ne se conjugue pas ou plutôt tout indique le contraire. Pensons à nos friches, production sauvage contradictoires entre des temps, des usages, des idéologies, productions habitées par la contradiction autant qu’elles nous permettent de l’habiter). L’imaginaire de la conjugaison permet de penser l’endroit, l’espace, le point médian où des forces, des trajectoires, des pensées se croisent et bifurquent. Il permet aussi de s’amuser avec cette langue qui nous oppresse autant qu’elle nous donne à se rencontrer et s’apprendre.
Conjuguer (aux premières personnes de l’infinitif)
Alors que je m’apprêtais à prolonger l’abécédaire de mes propres entrées, j’ai senti le vide que j’allais essayer de combler, par un geste qui n’est pas immédiatement le mien. C’est à travers ce mouvement de résistance, un mouvement aussi de l’ordre de l’attraction et du désir, que m’est venue l’idée d’une contrainte, celle d’écrire un abécédaire depuis des verbes à l’infinitif. Une manière aussi de ne pas chercher à définir, mais de continuer dans cette politique de l’indéfinition, cette poétique du désœuvrement que nous travaillons en friche et que je retrouve dans ce verbe « enfricher », verbe qui se conjugue aux premières personnes de l’infinitif. Je n’en suis pas sûr, mais il est possible que cette envie, cette idée d’écrire à l’infinitif soit, elle aussi, une manière d’avoir pris avec moi la lecture de « Nos cabanes ».
« Braver ici c’est d’abord « faire », dans une joie très matérielle — bâtir, ramasser, cultiver, cuisiner, repriser, fabriquer, jardiner, changer, de rythme, assembler, tresser, tracer, dessiner, relever, élever, creuser, prendre l’air, parler, citer… Bâtir plus vite et partout. Raconter des histoires, inventer des histoires, faire des histoires aussi : poser problème, rendre plus difficiles les gestes saccageurs.
(Ici s’égrène l’ample collier des verbes plutôt que le chapelet des noms, des identités ou des fonctions, la chaîne illimitée de ces infinitifs où s’anime l’intelligence même de la pratique. L’infinitif, ce mode non personnel et non temporel, qui sert à nommer un procès, un phrasé général de l’action : tiens, on peut aussi faire ça, et ça, et encore ça : l’infinitif, forme syntaxique du possible, de la possibilisation des gestes et des choses, à chaque instant déclose.) » [Marielle Macé, Nos Cabanes, p. 40]
Pour faciliter les conjugaisons, j’utiliserai pour les textes qui suivront le point médian de même que j’accorderai parfois de façon aléatoire au féminin ou au masculin. Si l’écriture cherche à être inclusive, elle cherchera surtout à faire milieu. Car j’ai aussi appris à utiliser et apprécier le point médian en tant qu’il permet de prendre en compte, depuis l’écriture, des processus, des expériences plutôt que des identités et des états. Le point médian fait friche, met en friche, au milieu, avec ce qui l’environne et ce qu’il environne (des lettres, des lectures, des écritures, des histoires, du papier, du code, des espaces…).