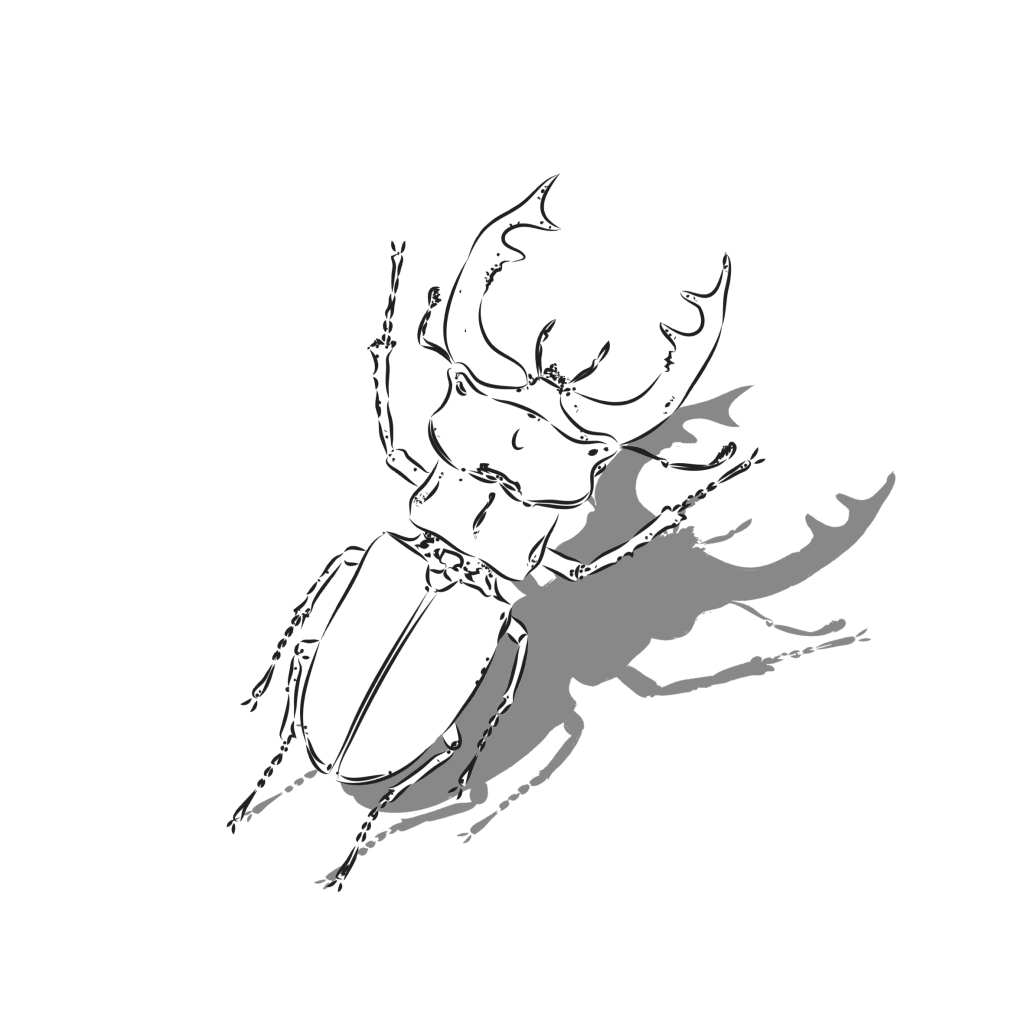L’entrée doublever raconte la façon dont j’ai peu à peu modifié l’idée qui guidait cette écriture. Quand j’ai envisagé d’écrire mon propre abécédaire, j’ai cherché mon geste d’écriture. J’ai commencé simplement par regarder l’indexe et, comme pour m’amuser dans ce geste, j’ai cherché les lettres les moins alimentées jusqu’à découvrir des lettres absentes. Je me suis arrêté donc sur le W. Absence qui produisait soudainement un espace vacant, avec de la place pour inventer quelque chose. Dès lors a commencé un petit jeu de mot, de langue et de langage.
Il est difficile de trouver un mot en lien avec l’expérience des friches qui commence par la lettre W. Par ailleurs, j’étais déjà parti sur l’idée de proposer un abécédaire sur le mode de verbes à l’infinitif. Je me suis alors rendu sur Wikipédia pour m’informer sur cette lettre de fin d’alphabet, absente de l’abécédaire. Sur l’encyclopédie en ligne, j’en apprends un peu sur cette lettre. Elle est apparue dans l’alphabet français pour adapter notre langue, et j’imagine plus largement les langues latines, à d’autres langues1. J’apprécie l’idée, celle qu’on incorpore des lettres pour que notre langue puisse vivre avec d’autres langues, pour faire des ponts. Le w c’est une lettre de croisement, de conjugaison. Des V qui se croisent, même si, souvent, la graphie efface ce croisement. Ce n’est d’ailleurs pas toujours un double v, mais parfois un double U comme en anglais.
Malgré la recherche, je ne trouve pas de mot, ni de verbe qui commencent par W. Ce n’est que quelques minutes après que je mesure que le geste réflexe, après avoir demandé aux personnes autour de moi, aura été d’aller sur wikipédia. Un geste qui peut tout à fait donner lieu à l’invention (qui existe probablement déjà à l’usage) d’un verbe dans lequel beaucoup se retrouveront, celui de « wikipédier ». Wikipédier ne reviendrait pas seulement à chercher sur wikipédia, mais à s’y perdre un peu, par succession de liens, quand pour entrer dans une notion, on sera tenté d’appuyer sur les notions bleutées et ainsi de suite.
Je continue mon jeu. Je pense à ce terme qui désigne la serpillère dans le Nord-pas-de-Calais, en Ch’ti : la wassingue. Un terme issu d’autres croisements de langues et notamment avec le flamand « wassen » laver, et wassching (lavage). J’imagine alors le verbe « Wassinguer » et découvre qu’il existe déjà en wikipédiant. Avec sa construction chantante, mais aussi ballante, le verbe wassinguer me raconte quelque chose de ces histoires de serpillières dans nos friches, nos expériences collectives. Qui passe la wassingue ? Qui ne la passe pas ? Qui prend le temps d’envoyer un mail, de faire un tableur, d’organiser un tour de ménage. Qui tente ce mail, ce travail, pour la énième fois ? Qu’est-ce que ces tentatives racontent de ce qui, dans nos friches, est parfois absolument consternant de reproduction d’un rapport genré. Qu’est-ce que cela raconte de l’auto-gestion en acte ? La conceptualisation de l’auto-gestion s’arrête souvent à ce passage de wassingue ou à la sortie d’un caddie dans lequel les bouteilles de bières s’accumulent jusqu’au débordement. Wassinguer a la sonorité de ces friches qui tanguent comme les longs poils de ces serpillères qui vont et qui viennent quand on la passe sans conviction dans des espaces communs. Des passages de serpillère dont on se demande parfois ce qu’ils nettoient, s’ils nettoient le sol, les rancunes ou la conscience de celles ou celui qui la passe.
Ce petit jeu d’invention continue et je m’amuse avec le terme anglais waste qui désigne « déchet ». Je m’invente un nouveau terme, celui de waster. Un verbe qui aurait la trajectoire langagière du verbe franciser « spoiler » signifiant que l’on révèle un élément important d’une histoire, revenant à gâcher (to spoil) l’histoire, le film, le roman. En wikipédiant, je découvre que sous ses aires d’anglicisme, le verbe « to spoil » en anglais est en fait un dériver du vieux français espoillier qui a lui-même donné lieu au verbe spolier.
Sans m’en souvenir clairement, il est possible que ce jeu autour du mot waste (déchet en anglais) dérive d’une pensée à propos de la traduction anglaise du terme friche : wasteland. Un terme qui se traduit en français par « friche » mais peut-être plus facilement par terrain vague. Par calque linguistique, on pourrait y lire aussi l’idée de terre (land) gaspillée (wasted). Pourtant, en deux cliques, cette fois-ci sur le site du CNRTL, très pratique pour wikipédier, friche apparaît précisément à l’inverse de la terre gâchée. Au-delà des premières définitions, qui renvoient la friche à une terre à l’abandon, inculte et incultivable, la friche, étymologiquement, fait plutôt référence à une terre fraiche, nouvelle, inexplorée, « gagnée sur la mer en l’endiguant » si l’on s’en tient à son origine néérlandaise2.
Alors, le verbe Waster désignerait dans son premier sens l’action ou le sentiment de gâcher quelque chose qui compte. Lorsque, par exemple, j’utilise un mot qui compte, disons le mot « friche ». Je waste, lorsque je l’utilise dans le cadre d’une argumentation, de la rédaction d’un dossier de subvention, et ce en totale contradiction avec ce qu’il agit comme imaginaire. Je waste, lorsque j’instrumentalise, que je domestique une poétique, que j’essaye de lui faire dire ce que je veux alors que son écologie se trouve précisément dans sa façon de nous échapper et de nous faire dériver.
Mais à l’usage, dans un jeu d’anticipation langagière, j’imagine aussi qu’à force d’avoir wasté dans l’histoire de l’humanité, le terme aura pris un second sens. Le sens se sera retourné contre lui-même. Waster, désignera alors le l’action de rédiger un dossier en friche, sans programmation, sans charger, sur-investir en intention, en projection. Ce sera aussi une manière de ne pas se trahir et de ne pas trop perdre son temps dans ces processus de sélection aléatoires et fortement discriminants que sont les appels à projet. Waster, ce sera aussi « s’autoriser » et ce afin de déployer des intentions et que celles-ci s’éprouvent dans l’action. Plutôt que de le sacraliser, on waste, on use le terme jusqu’à la corne afin qu’il « existe dans son écologie propre, c’est-à-dire en fonction de tous les dehors auxquels il se confronte et qui le mettent à l’épreuve » [Pascal Nicolas-Le Strat, Écosophie (d’un projet) in (un) abécédaire des friches, p.61].
Plus loin dans la lecture de l’abécédaire, cette pérégrination autour de la lettre W me conduit à envisager le verbe « Doublever ». Un verbe, nouveau, qui verbalise une lettre sans elle, qui verbalise une vacance. J’imagine alors le terme wacance et le verbe wacancer qui double la vacance d’une vacance. Wacancer renverrait ainsi à la nécessité de chercher des espaces vacants et de produire avec eux de la vacance, du vague, du désœuvrement. Comme enfricher en friche. Une possibilité donc pour penser des recherches et des créations sans œuvre, en processus et arrimé à des processus. C’est de cette wacance là que le terme enfricher relève.
Ce qui m’attire, qui fait tilt avec cette forme verbale, qui conjugue aussi parfaitement qu’elle s’accorde difficilement, c’est aussi la façon dont la wacance, comme double vacance, me renvoie dans sa sonorité et dans sa construction à l’idée de « double valence » permise par la préposition « en ». Cette préposition « marque en général la position à l’intérieur d’un temps, d’un espace, d’un état » et j’ajouterai : d’un processus. Une préposition qui poétise, métaphorise aussi nos lieux, nos gestes, nos espaces. « En » friche, faire une recherche en friche, c’est vivre une recherche qui fait l’expérience pour elle-même de la friche tout en s’exerçant dans une friche.
J’avais eu l’occasion d’envisager cette double valence lors d’une correspondance avec Pascal Nicolas-Le Strat à qui j’emprunte cette formule, et quelques-uns de ses mots, puisqu’il éprouve cette double valence depuis des recherches « en » expérimentation, en implication, en voisinant. Le verbe « Doublerver » relève de cette double valence, de cette gestuelle praxique qui double nos gestes, nos pratiques langagières, les retourne sur elles-mêmes. Doublever c’est le geste de la doublure, de ces doubles que ne font qu’un, qui font lieu(x), qui font friche.
1https://fr.wikipedia.org/wiki/W_(lettre)#:~:text=La%20lettre%20w%20est%20le,l’%C3%A9criture%20de%20plusieurs%20langues.
2https://www.cnrtl.fr/definition/friche