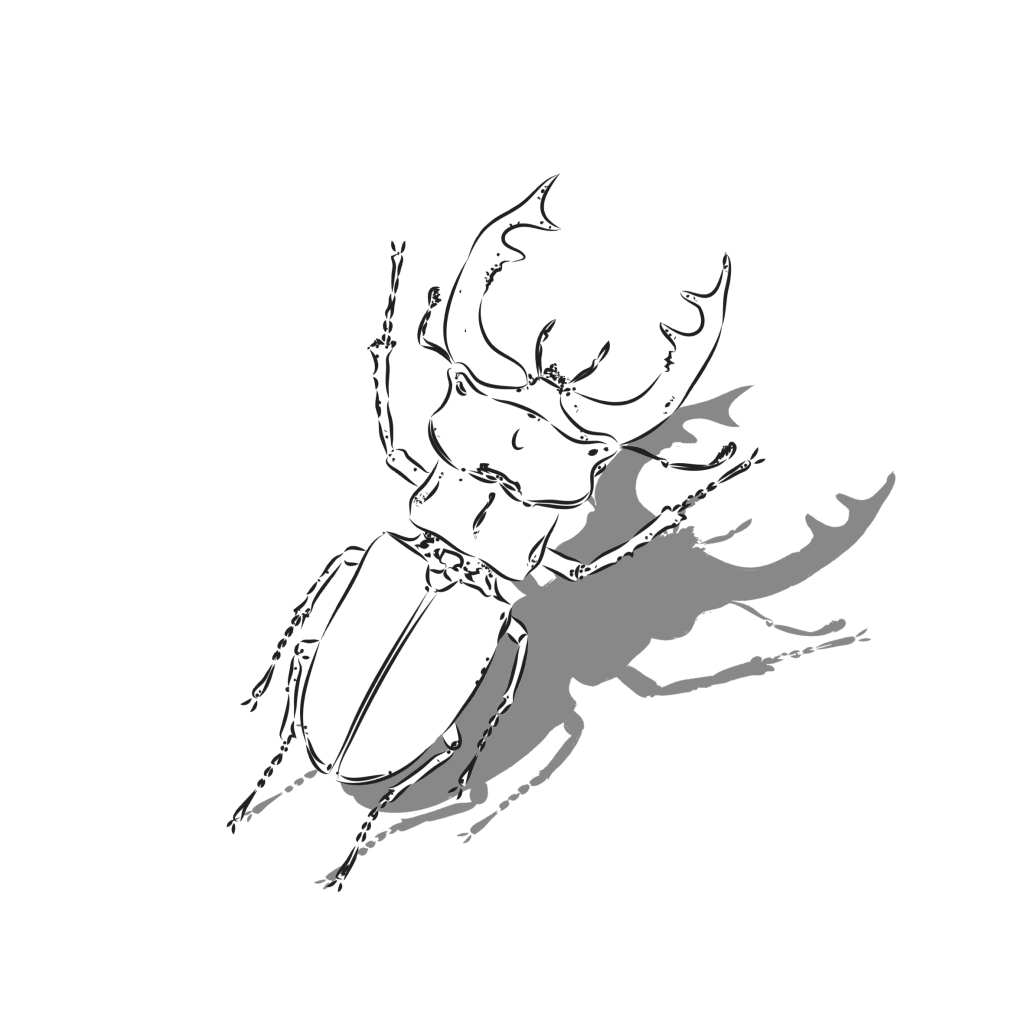En lisant l’ouvrage (un) Abécédaire des friches — qui entend revisiter « cette histoire[celle des friches artistique] des trente dernières années […] à travers les concepts, notions, constats, vocabulaire, récits… qui sont né de cette histoire » — j’ai nécessairement été interpellé, comme acteur d’une friche, comme praticien-chercheur dans ces espaces, avec ces espaces. Inévitablement, sont venues à l’esprit des idées, des envies d’écriture, d’ajouts, des mises en situation. Le livre m’a aussi interpellé, par des formules qui viennent mettre les mots ou active ce que nos friches sont aussi de contradictions.
Ce sont donc aussi les absences, heureusement inévitables, comme autant d’espaces disponibles pour d’autres textes, qui animent la présente écriture. Une absence de textes qui n’est pas propre au livre, mais intrinsèque à l’expérience d’écriture. Écrire doit permettre, par la lecture, de générer des écritures, quelles qu’en soient les formes (idées, actions, textes, coopérations). En cela, écrire me semble aussi être un geste qui consiste à écrire des absences, des espaces vacants, pour que l’autre puisse, en lisant, commencer à écrire son propre texte.
L’adage dit que la nature à horreur du vide, nos friches ont horreur du plein. Les invitations peuvent se formuler explicitement, comme dans l’abécédaire. Mais je ne suis pas dupe, c’est aussi parce que ma friche se joue quelque part avec l’université, dans l’université, que je suis surement plus prompt que d’autres à répondre à cette invitation et sous cette forme. Qu’est-ce que nous reproduisons alors ? Mais c’est aussi la nature invitante, accueillante, d’une écriture qui permet de convoquer l’expérience de l’autre dans la lecture et d’inviter à l’écriture. Ces écritures vacantes, accueillantes seraient d’authentiques recherches et création d’espaces dès lors qu’elles découvrent et qu’elles ouvrent plutôt qu’elles ne ferment depuis des certitudes, des bilans, des résultats. Que produisons-nous ?
Certaines lectures produisent donc un désir, mais qui s’exprime parfois dans les sociétés du plein d’abord comme un manque que l’on se devrait de remplir, de combler. Ce manque nous traverse, comme la trace perverse d’une société de la performance, de la compétition, de la domination, des preuves à faire, à administrer. Le manque se matérialise, se traduit dans l’écriture. Chaque mot que j’écris devra peser, devra dire quelque chose, être lourd de sens, remplir à bien sa mission d’instruction. Dans la société du manque, j’écris comme si je devais avoir raison, comme si je devais faire comprendre et être compris à la lettre et ce pour prouver que j’ai moi-même bien compris. Alors on imite, on mime par peur de la sanction, par peur du vide. Dans la société du manque, j’allais tenter, en vain, de combler les manques que j’observais dans l’abécédaire. Dans les mondes que travaillent nos friches, ces espaces deviennent les terrains vagues où l’on peut fabriquer nos cabanes.
En-friche, j’apprends à désirer sans manquer. J’apprends à ne plus savoir où donner de la tête dans ma vie entre volonté de faire, possibilité de faire et difficulté de faire. J’apprends aussi à ne rien avoir à y faire tout en trouvant toujours quelque chose à y faire. J’ai par exemple, toujours quelque chose à y écrire à la suite d’une expérience en espace public ; d’une assemblée générale ; d’une discussion de couloir ; d’une réunion. En friche, un manque peut toujours se bricoler en désir.
C’est à l’épreuve d’un manque que j’ai emménagé dans une friche artistique. Un manque que je pourrais traduire par des questions : puisque nos lieux sont en recherches, où sont les textes d’ordre alphabétique ? Où sont les textes qui adresseraient nos recherches à la recherche hégémonique, à l’université, pour dire qu’une autre recherche est possible, qu’une autre recherche est nécessaire, qu’une autre université est à l’oeuvre ? Ce sont ces textes que j’ai longtemps cherchés chez les autres. C’est parce que le lieu a résisté à ma voracité de texte, à mes méthodes et mon dictaphone, à mes ateliers d’écritures pour les capturer que j’ai dû me mettre à l’écoute différemment du lieu mais peut-être d’abord de moi-même, à l’écoute de mes manques et de mes désirs… C’est donc à l’épreuve d’une résistance de friche, que j’ai fait l’expérience d’une sociologie qui désir et qui devient désirable dès lors qu’elle ne répond plus à une logique de la commande, à une logique du manque (d’informations, de données, d’argent, de reconnaissance, de pouvoir), mais à une logique de création.
Dans nos friches, la forme alphabétique est tout de même présente. Elle est parfois vive, presque orale, publique, à travers nos échanges de mails sur la mailing-list « lieu-débat ». Il y a aussi les écritures expertes et administratives sous forme de dossiers de subvention et bilan, en communication, en acronymes, en devis. Il y a les écritures d’après coups, l’énième compte rendu d’un énième Groupe De Travail (GDT) ; l’énième charte ; l’énième modification de l’organigramme. On trouve aussi ces écritures sauvages, griffonnées à la craie, partageant des messages plus ou moins tendres et joyeux dans des langues qui s’inventent parfois en friche. Toutes ces écritures sont nos archives, précieuses, traces de ce que nos expériences de friche et d’ailleurs expérimentent comme démocratie en acte, imparfaites, impures, contradictoires.
Mais nos friches prolifèrent d’abord sans abécédé de façon an-alphabétique à coup de pinceau, de perceuse, de musique, d’espaces publics, de scénographie, de dispositifs socio-éducatifs, de composition d’espaces plus ou moins accueillants, plus ou moins ouverts. Chacune de ces écritures fabrique quelque chose d’une recherche en friche, travaille son propre rapport au monde, sa propre sociologie, produit ses propres objets, ses propres espaces et modes d’entrée en relation. Comment, ce que le mouvement des friches artistiques à participer à interroger, à critiquer en acte — les modes de productions capitaliste de l’art, de l’artisanat, de l’architecture, des corps, de la vie, de la ville — continue de le faire, de façon toujours plus diffuse et disséminée (à l’université, à l’école, en quartier, en espace public, dans les administrations) ? Cette question se piste dans ces formes d’écritures que sont nos pratiques et la façon dont nous mettons leurs processus en partage.
Une sociologie en friche, une sociologie politique consisterait justement à venir écrire aussi son texte en prise avec l’ordre alphabétique, cet ordre si cher à l’université et à travers lequel nous sommes sanctionné·es tout au long de la vie. Il y a donc nécessité à venir écrire des textes qui buttent, qui s’accrochent, qui reprisent, qui dérivent, qui s’oppositionnent. Une écriture qui ne serait pas que du dedans, mais en dedans. Cette écriture poétique, politique mais aussi sociologiques tenterait de participer elle aussi à la prolifération de nos expériences, par conjugaison d’expériences plutôt que par modélisation. Cette écriture ne réifierait pas des textes en œuvres ou des œuvres en textes mais au contraire, elle désoeuvrerait, a commencé par nous-même.
Cela implique des écritures praxiques, qui ne se réduisent à des textes sur la pratique, mais des textes à travers lesquelles nos pratiques agissent, parlent, crient, rient. Il s’agit d’écriture-friche à la manière dont une footballeuse se mettrait à écrire-foot, en une touche de balle, ou dont un boulanger roulerait ses mots et ses lecteur·rices dans la farine. Dans ces textes, j’imagine des lettres, des phrases qui s’enfilent, ondulent, se nouent ; j’imagine des matériaux, des tissus, des épaisseurs, des doublures, j’imagine un fil, l’aiguille, et son chat. J’imagine des textes piquant qui mettent des pointes sur les I comme ces mails cinglant adressés à l’ensemble de l’association. Le texte de ce texte, qui irait derrière, dans les coulisses de nos colères maladroites que plus personne ne comprend à force de n’entendre que la colère et pas ce qui l’anime (les tristesses, les nostalgies, les frustrations, les aberrations, les désirs, les impasses, les peurs, les doutes).
Ce sont ces textes que j’ai fantasmés chez les autres croyant vouloir pour les autres ce que je désirais en fait pour moi, devenir frichard, écrire en friche. J’ai projeté sur les autres avec le poids du manque ce que je peine à faire, parce qu’écrire depuis l’expérience n’a rien de simple. Je me rends compte aujourd’hui que c’est cette multiplicité d’écritures que je dois projeter sur la mienne, pour enfricher l’écriture.
Penser les manques, chercher ce qu’ils cachent de désir, trouver à écrire nos désirs, voilà peut-être une autre piste pour faire advenir ces textes, pour une écriture invitante, accueillante, pour écrire avec ma friche. Voilà un moyen d’enfricher, au moins un peu, mon logiciel de traitement de texte, d’épaissir mon écriture pour qu’elle fasse lieu-et-milieu, pour qu’elle fasse friche. Voilà un moyen d’éprouver la friche par l’écriture de textes qui partent dans tous les sens et dont le sens serait de faire partir nos mondes en friches1.
1 Je dois à Constance Ruiz ami fricharde qui m’a lancé cette formule à la volée.