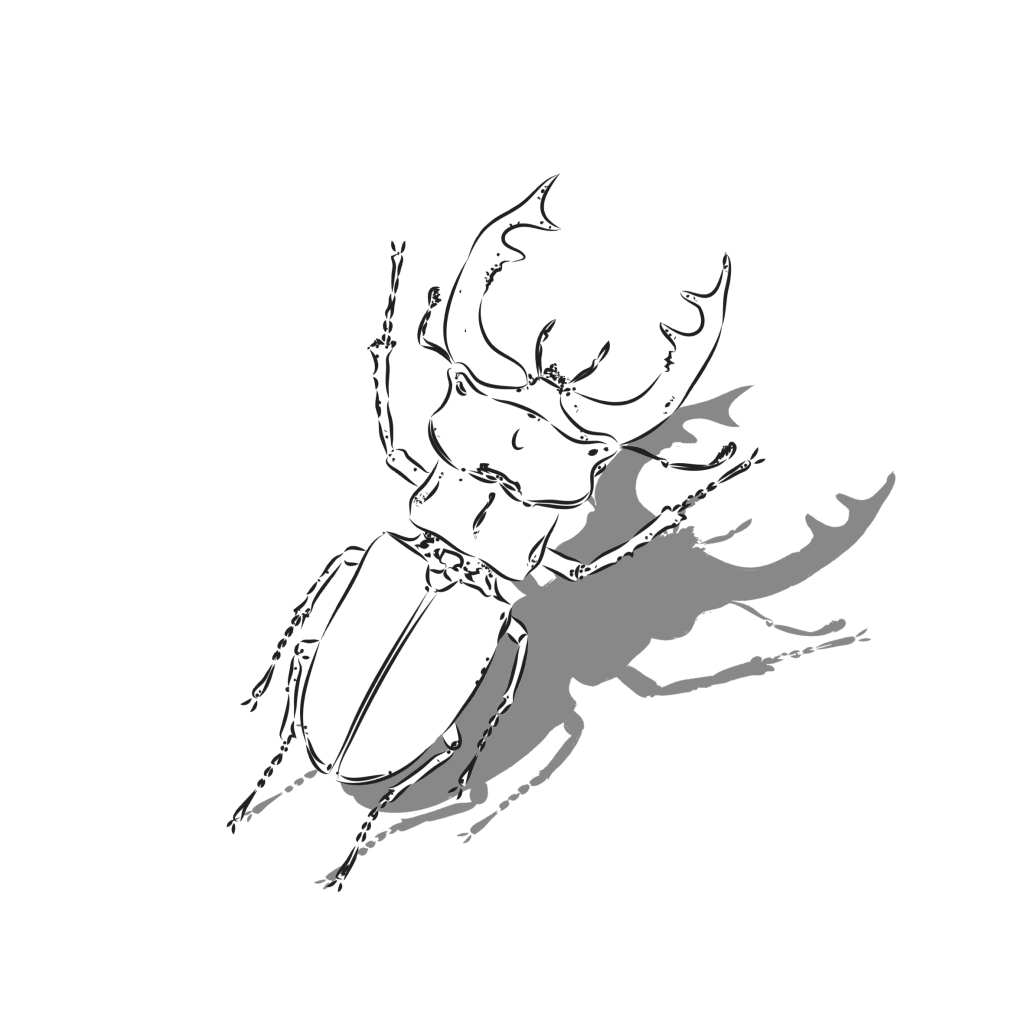Les 29 et 30 août 2024 avait lieu deux jours de séminaire réunissant des praticien·nes chercheur·e autour du motif suivant : « Disponibilité : Sentir-penser nos nécessités ». Je m’y suis rendu avec quelques feuilles pour prendre des notes et dans la poche de mon short estival le petit livre jaune de Mariel Macé : « Nos Cabanes ». En cette fin d’été, j’avais aussi, dans un coin de ma tête, l’envie et l’idée de cheminer autour de l’histoire d’une cabane. Une cabane avec laquelle j’ai le sentiment de faire recherche (en friche) depuis plusieurs années maintenant. En ouverture de ces deux jours, il est fait mention du travail de master 2 d’Hélène Tanné (https://en-corecherche.net/helene-tanne/), dont l’intitulé m’attrape à ce sujet : « Et si l’atelier était une cabane». Cet intitulé, que je prends en note, m’inspire un léger décalage : Et si la recherche était une cabane. Une question qui prendra de la consistance tout au long des deux jours, avec la proposition de faire insister ce « et si » faisant l’hypothèse de l’hypothèse pour sentir-penser nos nécessités. À la fin des deux jours, il nous est proposé de partager quelque chose qui s’y serait écrit, dessiné, pensé, partagé, quelque chose de ces « et si » pour peut-être en faire quelque chose. Avec un peu de temps et quelques conseils d’écriture et de lecture j’ai cherché dans le paysage de ma recherche une écriture-cabane à partager. Je n’y suis pas arrivé dans l’immédiat. J’ai conservé cette envie, cette nécessité de raconter cette histoire déjà pour voir ce qu’elle me raconte mais aussi pour faire trace de cet objet indécis, indéfini que j’ai fini par appeler « cabane » par commodité. Pour se faire j’ai pisté dans mon journal d’Entres (2018-2023), dans des notes, des réponses à des appels à projets et, parfois, dans mon téléphone, cet objet depuis cette appellation cabane. J’ai ainsi pu bricoler un texte comme on bricolerait une cabane, au jour le jour. Parce que j’aime les épisodes de séries qui commencent par leurs dernières scènes, j’ai choisi sans trop d’originalité de faire de même.
Jour 85: On me conseille le texte « 100 remarques environ sur une brève expérience de co-construction d’un dispositif d’investigation sociologique » de Pierre Grosdemouge (mars 2013, https://corpus.fabriquesdesociologie.net/). Il s’agirait d’une histoire de cabane. C’est ça une écriture cabane ? Sur le vif ? Une écriture-cabane pour sentir-penser la ville, nos villes, une écriture interstitielle, en position et déplacement ; une écriture-stock comme dans nos friches, nos associations où les couloirs laissent apparaître des stockages de toutes sortes (peintures, toiles, matériaux, stock-décoratif, charriots, décors). Un texte-cabane ou une écriture cabane ce serait peut-être aussi ça, un patchwork, une écriture-récup, de reprises de mots, de textes, de lectures, de citations, de notes, de journaux avec lesquels on bricole et on fabrique quelque chose. Une façon légère de s’occuper de nos encombrants. Dans le texte-cabane alors on peut se saisir de l’encombrant « épistémologie », stocké dans le couloir sans savoir quoi en faire et qui questionne celleux qui passent à côté : « c’est quoi ce truc? ». On s’en saisit sans précaution et on le clou, le coupe, le coud à son texte-cabane pour l’agencer différemment. C’est peut-être un moyen de faire un cheval de Troie pour entrer dans l’université dès fois qu’à l’entrée on vérifie dans nos sacs si on a bien son épistémologie. Une fois dedans on pourra peut-être déployer son épistémologie-cabane pour faire l’hypothèse avec d’autres : et si l’université était une cabane, une friche, autrement populaire. Dans un texte-cabane, un mot, un objet s’agence nécessairement différemment. On utilise des tirets par exemple et/ou en l’aspirant avec d’autres mots ou les deux : épistémo-politique, épistémologie-cabane, un devenir-cabane. On n’a pas besoin d’inventer des mots, juste de les bricoler, de les augmenter comme lorsque qu’on met une carte qui claque entre les rayons d’un vélo. Ça reste un vélo mais ce ne sont plus les mêmes sensations quand on roule avec. Une épistémologie-cabane ne signifierait rien de plus et rien de moins que de penser avec nos cabanes. On le fait en lisant «Nos cabanes » de Mariel Macé, celles « des ZAD jusqu’aux campements qui devraient n’avoir rien à voir les unes avec les autres. Pourtant je [Marielle Macé] les crois animées par une même lutte, celle d’un « vivre autrement » : se refaire un séjour quand on en a pas, ménager et réaménager des mondes. Ici s’énonce au plus fort le rêve d’une autre vie, d’une autre ville, déjà là par endroits, à portée de main ». On le fait avec cette longue liste de cabanes à la puissance poétique qui nous invite à la prolonger de celles auxquelles on pense. Les cabanes des grandes frères et soeurs construites dans les arbres et que l’on visite la jambe tremblante sur l’échelle ; celles qu’on se souvient avoir fabriqué à la hâte avec un ami qu’on aime quelque part un peu perdu en Irlande. Des cabanes de couettes, de draps, entre chaise et penderies, dans lesquelles on se réfugie avec une lampe de poche et de quoi lire ou un briquet et de quoi fumer selon l’âge et l’état d’esprit ; une de celle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui se déplace jusqu’au quartier de la pleine à Marseille et que l’on retrouve récemment dans le film du média Libre Primitivi (https://labataille.primitivi.org/); celle qu’on aperçoit à Vaulx-en-velin « aux terres » au fond du champ avec écrit à l’entrée « interdit aux adultes » ; celle que le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) a construit avec le collectif d’architectes Pourquoi Pas !? au sein de l’occupation temporaire la Rayonne : celles d’une friche artistique à l’angle de la rue Alphonse Lamartine à Lyon entre visible et invisible. Autant d’expériences qui permettent de faire savoirs et connaissances et de les réengager dans des expériences, autant de cabanes qui nous feront fabriquer et écrire des cabanes. On se dit qu’une épistémologie-cabane c’est donc peut-être ça, un texte cabane qui s’écrit depuis les savoirs et connaissances que l’on fabrique en fabriquant une cabane, mais surtout des textes qui s’écrivent depuis nos cabanes. Des textes avec lesquelles on peut se déplacer lorsque pour une raison ou pour une autre on doit quitter sa cabane.
– Jour 1 La cabane n’existe pas, c’est d’abord une idée. Comme idée, elle existe plutôt comme « exposition mobile », « m² de friche ambulante » – Jour 2 La cabane n’existe pas mais elle commence à (s’)écrire – Jour 3 La cabane apparaît ailleurs, dans un travail autour des archives au sein des lieux intermédiaires (CCO La rayonne, Friche Lamartine). C’est une autre idée, au pluriel : Des cabanes en cartons d’archives. – Jour 4 Les cabanes en cartons seraient des cartons d’archives pour pouvoir faire l’expérience d’entrer dans son carton d’archives — Jour 5 Pas tout à fait parallèle, pas tout à fait perpendiculaire, un peu en zig et en zag, l’idée d’exposition-mobile continue de faire son chemin – jour 6 Les cabanes en carton sont des prétextes pour réaliser des archives en expériences. On fabriquerait des cabanes sur lesquelles se colleraient des archives – Jour 7 – « Les cabanes » est une trouvaille pour négocier une recherche entre des lieux (une friche, des occupations temporaires, un comité scientifique, le bureau d’une salariée), des personnes (des amis, des inconnus, des personnes sympathiques et moins sympathiques), des fonctions (traces, récits, archives, recherches), des rôles et des statuts (employés, services civiques, admistrateur·rices, bénévoles, services civiques, chercheur·es, directeur·rices, artistes), des intérêts, des nécessités (visibilités, vie associative, administratives, budgétaires, financières, calendaires). — Jour 8 Dans la cuisine de l’occupation temporaire du CCO-La Rayonne une première cabane en carton voit le jour, c’est une maquette.

– Jour 9Les cabanes en cartons seraient des assemblages de panneaux pour pouvoir être en ex-position (stockage vivant) sur les murs quand elles ne sont pas en position « cabane » – (Jour 10 Dans le moment de l’idée cabane, se découvre aussi l’idée d’objet intermédiaire (la clé par exemple) comme des objets « entre le politique et la vie quotidienne ») –Jour 11 L’idée-cabane se diffuse, d’autres veulent s’en fabriquer une, l’idée commence à faire lieu, à faire méthode. L’absence de préalable, le refus de la prédation et la patience comme « intention » de recherche, fonctionne – Jour 12 L’idée-cabane est programmée pour un évènement par la direction d’un lieu– Jour 13 Une pandémie mondiale et un confinement se rapproche et on ne le sait pas encore – Jour 14 Les idées, les événements qui n’ont eu lieu que comme idée, sont confinées à leurs formes-idées, la cabane qui n’existe pas archive des choses qui n’ont pas existé – Jour 15 La cabane se fabrique dans un jardin, sur une table de ping-pong comme établi, entre deux copains d’enfance. – Jour 16 L’idée-cabane(s) qui n’a pas existé, fait exister, en existant, d’autres devenir, son devenir exposition mobile, exposition en position, friche ambulante. On se dit que la cabane est à ontologies mulitples. Ce que nous dit Pascal Nicolas-Le Strat à ce propos : la cabane « ne saurait se réduire à ses développements les plus visibles et les plus englobants mais qui se compose également d’une multiplicité de devenirs resté à l’état de fragments, à peine ébauchés, mais qui ne demandent qu’à se déployer[…] » ( Pascal Nicolas-Le Strat, « Multiplicité interstitielle ». Multitudes, n° 31(4), 2007, 115-121.) Jour 17 – La cabane, stockée sur le toit d’un atelier de la Friche Lamartine (site Robinetterie), qui existe sans exister redevient une idée : la cabane de chantier – Jour 18 La cabane-idée-friche-ambulante-de-chantier pourrait être un dispositif de porteur de parole inspiré du travail de Jérôme Guillet. Ce qu’il nous dit : « L’apparition et le développement de l’outil Porteur de paroles, dans lequel c’est le public lui-même qui produit le contenu, nous apparaît comme la solution, le dispositif avec lequel nous n’aurons plus rien à apprendre aux gens » (Jérôme Guillet, Petit manuel de travail dans l’espace public, 2019, p. 14) – Jour 19 Il y a une pédagogie des cabanes qui n’est pas une pédagogie. Jour 20 – En réponse à un appel à projet, la cabane devient fragment d’un « obervatoire sympoïétique de la ville ». Ce que nous en dit Donna Haraway : « Sympoïese est un mot simple, il signifie « construire-avec », « fabriquer-avec », « réaliser-avec ». Rien ne se fait tout seul. Rien n’est absolument autopoïétitique, rien ne s’organise tout seul. […] les Terriens ne sont jamais seuls. Telle est l’inévitable conséquence de la sympoïèse. C’est un mot pour caractériser de manière adéquate des systèmes complexes, dynamiques, réactifs, situés et historiques. Un mot pour désigner des mondes qui se forment-avec, en compagnie» (Donna Haraway (traduction Vivien García), Vivre avec le trouble, 2020, p. 115) – Jour 21 Dans l’observatoire de la ville Sympoïétique la relation constitue le plus petit espace d’analyse possible. La cabane s’intéresse à des unités différenciées qui se distinguent dans leur mise en relation, aucune des deux unités n’est l’essence de l’autre (exemple deux extrémités d’une même frontière la vie et la mort). – Jour 22 Comme observatoire la cabane se donne à voir plus qu’elle ne donne à voir. – Jour 23 La cabane est dans le paysage. Elle ne naturalise pas, ne bucolise pas elle socialise et politise mon paysage et le paysage de ma recherche celui dans lequel je me déplace, j’agence, je m’agence. La cabane ne doit pas participer à des formes de dépolitisation des espaces et des actions comme pourrait le faire le terme d’éco-système. Jour 24 Comme m² de friche, la cabane est un fragment de territoire. Un territoire n’est pas nécessairement continu. Le fragment n’agrandit pas le territoire il l’étend. Jour 25 La cabane peut-être une guitare (fête de bois).– Jour 26 La cabane pourrait-elle se conjuguer avec son idée-carton d’archives ? De carton à cabane de chantier c’est le rapport que l’archive vivante, en expérience, dans les langues, les corps, les pratiques les usages entretien avec la ville qui se raconte. – Jour 27La cabane travaille l’idée d’un espace public en relation à l’espace public. Entre un espace public convivial et un espace public hostile. – Jour 28 – La cabane change d’espace de stockage, elle est stockée dans la cave du site Tissot, rue Tissot (9e arrondissement) administré par l’association Friche Lamartine – Jour 29 Une artiste-végétaliste-amie vient coudre du lichen et du bois sur la cabane en bois, en toile et en grillage à poule – Jour 30 La cabane devient écran pour le film expérimental Dividus. Elle pose la question du rapport à l’oeuvre. Comment la cabane vient poser cette question depuis son refus d’être une œuvre ? Comment pose-t’elle l’enjeu d’une œuvre « qui ne se réalise qu’en présence d’autrui ». Qu’en est-il de la recherche ? La cabane fait recherche en présence d’autrui. Comment rendre présent l’autre dans une recherche ? – Jour 31 Le devenir-Lichen de la cabane. la cabane sur-vit, elle se délocalise – Jour 32 – La cabane comme objet à part entière devient objet de recherche et objet en recherche. C’est un terrain d’investigation. On peut fabriquer son terrain avec des clous, des vis, des tasseaux, de la récupération, d’autres personnes ect… On ne le fabrique pas conceptuellement, méthodologiquement mais matériellement. De la même façon on construit l’objet de recherche, Il se problématise à l’usage. Jour 33 – Plus qu’une cabane, la cabane est un mouvement d’idées, elle met en mouvement des idées. La cabane ne fait-elle pas sociologie depuis des mouvements ? – Jour 34 – La cabane est une friche – Jour 35 La cabane est un espace inter-indépendant
–Jour 36 : Première sortie de la cabane :
Je (moi-cabane-homme-chien) vibre mais je souffre. Je vibre à la moindre aspérité sur le trottoir qui fait dévier mes roulettes, aux rythmes et sons qu’elles jouent sur les plaques d’égouts toutes différentes. Je pense à mille choses, à ma vie, à ce que je fous là, ce que je vais devenir. Je pense à l’espace public à l’espace comme public, je pense à l’art comme un commun au travail, mon attrait pour nos friches. Je sens que l’espace me regarde comme s’il était mon public, les feuilles applaudissent, les voitures m’encouragent, des téléphones me suivent, des personnes sourient, le soleil est éclatant. Il fait chaud. Toutes ces sensations se mélangent, se perdent. J’arrive 4 heures après, exténué. La traversée a été douloureuse. On peut parler de journée caniculaire. Au moins deux roues ont complètement lâchées et ce malgré un bricolage sur la route avec l’aide d’une personne au travail dans l’espace public qui me dépanne d’un tournevis et d’une vis. Je termine l’épreuve en me trainant littéralement. On ne peut pas dire que j’arrive dans la salle d’exposition, mais plutôt que j’y échoue.
Jour 37 – Après sa traversée, la cabane s’expose, non sans paradoxe, comme archives lors d’une exposition d’archives des expériences de la friche RVI et de la friche Lamartine à l’occasion des journées de réflexion Mémento les 4 et 5 juin 2021 (https://autresparts.org/quelques-images-de-memento-4-5-juin-a-lyon/). Difficile de le deviner mais certaines traces et migraines archives la traversée de la veille. Un cartel est rédigé à l’occasion : « Cabane ; carton, écran ; observatoire de la ville sympoïétique ; fragment de friche ; niche écologique… ; Co-création d’Amaël Kasparian, Lola Roubert, Laurent Reyes, Lou Baissade, Thomas Arnera. Dans l’espace et dans la cabane sont posées des livres, des fanzines, des archives qui parlent de chiens et d’une recherche en friche – Jour 38La cabane dessine les contours d’une sociologie micro-politique et de ce qu’une sociologie aurait à faire, à voir avec la recherche-création. Combien et comment sont payées les personnes qui y participent? Quelles recherches existentielles se croisent, se discutent dans l’atelier? Comment la cabane est-elle financée ? L’est-elle ? Depuis quels motifs ? Qu’est-ce la cabane raconte de la friche, de son déménagement ? Que raconte-t-elle d’une recherche qui opère entre des recherches ? De la division de l’association Friche Lamartine de la rue Lamartine aux trois sites (Robinetterie, Villa Pionchon, Tissot) ? Comment elle le raconte, l’écrit ? Qu’archive t’elle ou comment fait-elle archive ? Que dit-elle des rapports de genre dans mon corps, dans notre atelier, dans la friche ? En attribuant ces questions à ce qui serait une micro-sociologie, la cabane dit une discipline à l’instant T, elle prend en photo des idées. La discipline n’est pas une discipline, elle est vectrice d’un récit morcelé – Jour 39La cabane comme objet intermédiaire est un espace de transition, un espace potentiel. – Jour 40 La cabane s’imagine comme une université sauvage, publique – Jour 41Un amiartiste n’aime pas la cabane. La cabane-oeuvre est source de conflit – Jour 42 Le lichen devient écran, la cabane devient cabane/lichen, la cabane sur-vit. Jour43 La cabane désoeuvre et fait recherche aussi au moment où elle commence à porter les histoires de celleux qui la fabrique. L’oeuvre ne nous intéresse pas, l’ouvrage oui. Jour 44 La cabane-idée devient un kiosque parce qu’une constructrice y ajoute une petite boîte à fanzine à l’entrée. La cabane est stimulante. Jour 45 La cabane est une ville, un fragment de ville, de friche, d’espace public, la cabane est un devenir-fragment. Jour 46 – La cabane est un devenir, il y a un devenir-reherche de la cabane autant qu’un devenir-cabane de la recherche. Ce que nous disent Gilles Deleuze et Félix Guattari : « Le devenir ne produit pas autre chose que lui-même. C’est une fausse alternative qui nous fait dire : ou bien l’on imite, ou bien on est. Ce qui est réel, c’est le devenir lui-même, le bloc de devenir, et non pas des termes supposés fixes dans lequel passerait celui qui devient. Le devenir peut et doit être qualifié comme le devenir-animal sans avoir un terme qui serait l’animal devenu. » (G. Deleuze, F. Guattari, Milles Plateaux, 1980, p.291). –Jour 47 La cabane donne envie de partager une boisson et/ou un gâteau avec des inconnus dans la rue. –Jour 48La cabane traine en position dans un espace de stockage alors qu’elle n’a rien a y faire. La cabane (s’)encombre. Jour 49Une cabane (conceptuelle) fait lieu dans un milieu, elle fait lieu du terrain vague où l’enfant la fabriquera. – Jour 50 Le maître veut que la cabane soit participative et que d’autres maîtres financent la cabane sinon il ne financera pas ce qu’il n’a jamais vraiment financé, ce qu’il n’a jamais regardé. Il faut ruser et déjouer le maître (Norman Ajari propose de « désespérer le maître » dans Noirceur, 2021, p.17). Jour 51 – La cabane est un partenaire en recherche-création. – Jour 52La cabane est le lieu d’une enquête artistique, elle devient lieu de rencontre, d’échange, de lecture, d’écriture, d’enregistrement en espace public. Elle pose simultanément la question de ce qu’elle agit en mineur et ce qu’elle rejoue de majoritaire. – Jour 53La cabane s’équipe. Autour de son toit qui, en position devient table, s’ajoute des chaises, des tapis, un cabas. Jour 54 La cabane est une écriture et un lieu d’écriture. Des écritures de cabanes, dans la cabane, avec la cabane. Jour 55La cabane devient mobilier dans le square pas loin de là où elle est devenue idée (cf jour 1). Jour 56 La cabane s’expose comme lieu non plus seulement comme objet, c’est un lieu exposé plus qu’un lieu d’exposition. – Jour 57 La cabane est un lieu à abandonner un moment ou pour toujours. La laisser, la délaisser pour que les enfants de tout âge s’y attable. Jour 58La cabane-écran du film Dividus participe d’une œuvre qui se réalise en présence d’autrui quand le film est partagé près du square aux usager·ères du square où il a été filmé – Jour 59 La cabane retrouve sa fonction idée, celle d’exposition-mobile, carton d’archives pour « restituer » l’enquête artistique. – Jour 60La cabane déménage difficilement du siteTissot qui sera bientôt détruit pour le 7e arrondissement, elle s’installe dans un grand bar vide et plein de fantômes – Jour 61 La cabane est un lieu injuste, a-juste, ajusté, ajustable. – Jour 62 Faire friche avec une cabane, dans une cabane c’est plus léger que dans une friche. – Jour 63 février 2024 Il ne (me) reste plus que la cabane. La cabane fait aussi sociologie dans la solitude. – Jour 64 La cabane fait recherche en friche et s’éprouve dans une triple perspective critique, possibiliste (nous dit Cécile Offroy, https://en-corecherche.net/cecile-offroy/) et précaire (nous dit la psychothérapie Institutionnelle) – Jour 65 La cabane est toujours en friche. Mariel Macé nous dit « qu’ici vient immédiatement le trouble, la gêne – grand embrouillement du réel, décidément . Car le sens apporté à la mobilité, au recyclage, au temporaire peut changer du tout au tout. Certains dénoncent une situation sociale à ce point dégradée que les nantis (nous) n’ont plus vraiment besoin d’être citoyens, et croient pouvoir se passer des solidarités nationales et des soutiens de l’État – se rêver squatteurs lorsqu’ils vivent en libéraux, chasser plus loin les Roms en jouant aux nomades dans les friches bien trop scénarisées. Les plaisirs de la cabane flirtent aussi avec ça.
Pas seulement pourtant ; car les expérimentations sont réelles, et les joies aussi ; des emplois s’inventent des lieux de vie se multiplient, des imaginaires se connectent pour de bon. La friche, le recyclage deviennent des leçons de villes. […] D’ailleurs, depuis leur propre précarité, la plupart des jeunes gens savent très bien qu’ils se relient à des précarités d’un tout autre ordre – à toutes ces crises qui dessinent les conditions du monde futur et déjà présent, celui qui devra faire avec toutes les deterrestrations .» (Mariel Macé, Nos Cabanes, 2014, p. 61-62) – Jour 66 Dans un séminaire dit doctoral, Rachele Borghi nous invite à utiliser la cabane pour transformer la rage en énergie – Jour 67 La cabane est un objet post-gentrification qui pose la nécessiter de penser des exercices de dégentrifications des pratiques et des usages. Dans la cabane on s’interroge encore et toujours, lassablement, sur la gentrification entendue à la fois comme processus aux rétombées et mécanismes concrets à la fois comme concept pratique pour ne plus rien faire et ne plus rien penser. On se demande dans la cabane, avec la cabane comment nous sommes gentrifié·es (corps, pratique, esprits, usages, langages, politique publique). Comme lieu, espace, pratique, recherche et imaginaire la cabane naît après le relogement de la friche RVI à la friche Lamartine (après 2010). Cette séquence nous apparaît comme une opération de gentrification d’une expérience. La cabane de façon non-intentionnelle, non programmatique est aussi l’expression d’une tentative dans un espace gentrifié, l’expression d’une tentative post-gentrification. L’expression d’un agir contre, tout contre la gentrification. On sait que nos sorties ne sont pas des exemples d’exercices de dégentrification, mais possiblement des tentatives, très limitées, d’agir dans des sociétés post-gentrifiées. Car malgré tout, dans la cabane nous ne croyons pas que la gentrification soit le fin mot de cette fin de l’histoire sans fin. Il y a bien des histoires à raconter dans, par, contre la gentrification. Il y a donc un enjeu à se raconter entre artistes-chercheureuses-précaire-joyeux-en-friche-travailleuses-sociales-intermittentes-sans-ou-avec-expérience-au-profit-de-restriction-budgétaire-et-au-détriment-dudit-travail-social-intervenant-péri-scolaire-et-autres-établissements-publics-et-parapublics-plongeur-chomeur-vacataire-etc ces histoires que l’on ne veut/peut plus se raconter. Des histoires forcément dans, par, contre nos contradictions. Certaines discussions dans la cabane, où se partagent nos doutes, nos colères, nos incompréhensions, nos inexpériences sont de très bonne pistes pour inventer des exercices d’auto-dégentrifiction. – Jour 68 On s’interroge sur le devenir-pédagogique de nos friches, de nos cabanes, sur la nécessité de faire friche dans les sociétés de recherche-création. Ce que nous dit Yves Citton des sociétés de recherche-création : « Vue depuis la planète saturne, la recherche-création emblématise une phase de l’histoire au cours de laquelle, sous la pression de solidarités objectives de plus en plus étroites et de problèmes de plus en plus insolubles, chacune et chacun est appelé à devenir à la fois chercheur/chercheuse et artiste. Ce qui n’était autrefois que des professions marginales et minoritaires semble devoir relever désormais d’une formation impérativement commune. » ( Yves, Citton, « Post-scriptum sur les sociétés de recherche-création », 2018, p. 106) – Jour 69Dans la rue du nouveau site où elle se stocke en position, la cabane prolonge une permanence de recherche en friche intitulée « transformer la rage en énergie »
Jour 70: J’ai (moi-cabane-homme-chien) décidé de m’ajouter un banc. C’est important. « poser un banc, c’est politique » nous dit le collectif En Rue dans son fanzine #0 (https://comme-un-fanzine.net/en-rue-00/) . Avec ce banc, je m’accompagne, je m’équipe d’En Rue, de la sociologie des tentatives de Louis Staritzky (https://en-corecherche.net/louis-staritzky/). Il en va de même avec les tapis, des amies marseillaises et grenobloises. Elles viennent politiser l’espace, le soin, défendre une écologie politique du soin, plutôt qu’une économie du bien être. Quand se déploient ces tapis, que je les décale de quelques centimètres pour les agencer comme-ci ou comme ça, je suis avec Gabrielles Boulanger. Je suis aussi avec Cécile Léonardi (https://en-corecherche.net/cecile-leonardi/) sa sociologie-active entre soin et architecture (son architecture-publique-du-soin?). Seul, là, en espace public quelque chose d’un collectif affranchi du collectif opère, écrit le dispositif. C’est ce que j’imagine être ces collectifs de recherche-création qui existent parce qu’ils opèrent depuis des processus précaires, des coopérations, des conjugaisons de toutes formes, de tout temps, de toutes les personnes du singulier et du pluriel (des friches). Cet ensemble relationnel de personnes, d’intentions, d’objets, d’espace, de temporalités me compose comme cabane, comme collectif de recherche-création. La recherche-création nous intéresse comme devenirs, ici un devenir-cabane de la recherche, un devenir-collectif. – Jour 71 Avec la permanence la cabane cherche à faire espace public à l’intérieur. – Jour 72 La cabane, sans attendre le maître, mais pour continuer à le désespérer, se transforme en atelier sauvage et convivial de carnet en espace public. On se dit que c’est peut-être un moyen pour qu’un fragment de son paysage rencontre le paysage des autres. On transforme notre rage en énergie. – Jour 73 Dans la rue, comme cabane, comme désœuvrment, comme espace, comme atelier, la cabane fait lieu, elle fait friche. Une dame — en caressant du lichen — dit à son petit fils qui coud un carnet : « regarde c’est artistique parce qu’il y’ a des idées ». Ce que nous dit Jacques Rancière de nos friches : « Sans doute y a-t-il loin de là à faire des chefs d’oeuvre. Les visiteurs qui apprécient les compositions littéraires des élèves de Jacotot font souvent la moue devant leurs dessins et leurs peintures. Mais il ne s’agit pas de faire des grands peintres, il s’agit de faire des émancipés, des hommes capables de dire et moi aussi je suis peintre, formule où il n’entre nul orgueil mais au contraire le juste sentiment du pouvoir de tout être raisonnable. » (Jacques Rancière, Le maître ignorant, p. 113). – Jour 74La cabane s’ouvre pour délimiter un espace, les roulettes peuvent se bloquer, la cabane peut faire office de paravent mais que lorsqu’il n’y a pas trop de vent… – Jour 75 La cabane devient fantôme, elle encombre. Dans un grand espace vide on dit gentiment et poliment qu’elle accentue la dimension fantomatique. C’est vrai que ce n’est pas là qu’elle vit le plus. On se demande sérieusement si ce n’est pas la fin de la cabane – Jour 76 La cabane lorsqu’elle se déplace raconte plein de petites histoires. Quelqu’un nous dit que c’est « carrément intéressant », on a bien envie d’essayer d’écrire. – Jour 77 La cabane est rapidement démontée pour l’inauguration d’une friche par la Ville de Lyon, puis à nouveau pour la biennale d’art contemporain pour laisser la place aux œuvres. La cabane est stockée dans un hangar. – Jour 78 Au centre social coopératif le 110, à Saint-Denis, on découvre avec surprise une vraie cabane réalisée à l’aide de cartons d’archives. On la prend en photo en se rappelant de cette idée-cabane qui nous semble déjà loin.

– Jour 79 Lors d’un séminaire, est évoqué le travail de master 2 d’Hélène Tanné. L’écirture-cabane qui cherche son texte-cabane se dit qu’il y a un beau motif pour raconter une histoire. À ce moment-là, on s’interroge sur le besoin où non du terme épistémologie. On se dit qu’il n’est pas indispensable à nos recherches. Qu’il a surtout tendance à rendre des recherches légitime et d’autres illégitimes. Depuis la cabane ça ne nous intéresse pas vraiment, mais ça nous encombre. Quoi qu’il en soit avant, après, autour, au milieu de l’épistémologie il y aura toujours l’expérience(s). L’épistémologie c’est un gros mot pour dire comment, depuis des expériences, qu’on se reconnaît à la fois communes et singulières, on fait savoirs et connaissances. Jour 80 La cabane s’encombre elle-même. – Jour 81 : La cabane est logiquement retirée de l’espace de stockage officieux et pirate par celleux qui s’investissent pour transformer l’espace afin de pouvoir y travailler convenablement. On reçoit un message très gentil avec une photo pour nous dire où elle a été placée : « Salut ! De façon temporaire, on a mis délicatement ta cabane dans le couloir du pôle image. Bisous ». On a peu honte… Ça sent le sapin (ce qui n’est pas notre bois)

–
Jour 82 On se dit que la cabane à plusieurs adresses : Friche RVI (imaginaire), Friche Lamartine (rue Alphonse Lamartine adresse qui n’existe plus), Friche Lamartine (ou Robinetterie), Site Tissot (redevenu un squat après notre départ), Friche du 7 (pour 7e arrondissement lyonnais), un hangar, une cave, un toit d’atelier, un square, un passage, des bouts de trottoirs, un séminaire dit doctoral. – Jour 83 : Alors que le texte cabane s’écrit, on regarde nos mails, Omar nous dit que la cabane est un décor.

Jour 84 La cabane raconte des emménagements, des aménagements, des déménagements. Mais, comme objet, comme lieu intermédiaire, elle raconte surtout l’aménagement d’une recherche en friche. Par ailleurs, il semble qu’on ne déménage pas une cabane on cherche plutôt où, comment et avec qui en fabriquer des nouvelles. – Jour 85 (revenir au début du texte).